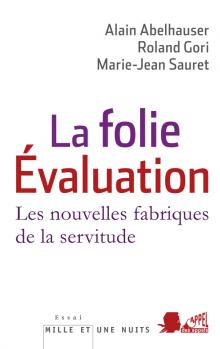Introduction.
Qu’on y réfléchisse quelques minutes et on s’apercevra que non seulement l’évaluation est particulièrement chronophage, que non seulement les moyens qu’elle met en œuvre s’avèrent particulièrement disproportionnés en regard des résultats qu’elle obtient mais que surtout, elle opère comme une gigantesque machine à détourner tout un chacun de sa fonction, à dissuader tout un chacun d’exercer son métier, de faire ce pourquoi il est fait : en les poussant à n’avoir d’actions que susceptibles d’être évaluées à l’aune prévue, en exigeant d’eux qu’ils fassent du chiffre et ne fassent que cela, elle détourne les chercheurs de leurs recherches, les soignants de leurs soins, les enseignants de leur mission de formation et de transmission, les juges de leur jugement, les artistes de leur art, les policiers de leur action de prévention et de protection et j’en passe. Non seulement l’évaluation se constitue comme un remarquable outil d’asservissement social et une remarquable mesure d’appauvrissement intellectuel mais c’est aussi un processus très efficace pour vider le cœur des métiers de sa substance même. Non seulement elle est abusive et débilitante, mais elle est socialement ravageante. Nous exagérons ? Voyez les chapitres qui suivent.
L’évaluation participe d’une forme de logique, bien sûr, ou plus exactement qu’elle épouse si parfaitement une certaine logique qu’elle pourrait en constituer le paradigme absolu. Elle n’est qu’un moyen, certes, un moyen qui laisse transparaître les fins qu’il sert, bien sûr, mais surtout un moyen pris dans une telle forme de logique qu’il ne tarde pas à devenir une fin en soi, - à s’imposer comme étant sa propre fin. Ainsi en va-t-il dans certaines occasions : ce n’est plus alors la fin qui justifie les moyens, c’est encore pire, ce sont les moyens qui justifient la fin, ou qui se justifient eux-mêmes. Une telle logique, redoutable s’il en est, s’apparente pour une bonne part à celle qu’on identifie en psychopathologie comme obsessionnelle : une logique éminemment mortifère...
L’évaluation se coule et se fond dans cette logique : c’est en cela qu’on peut la considérer comme un symptôme, mais à condition d’admettre qu’il s’agit d’un symptôme social, aux deux sens du terme « symptôme » : une solution que la société tente de trouver pour faire face à ses difficultés et un signe de ses difficultés, révélateur de ses apories, témoignant du « malaise inhérent à sa culture ».
LE CULTE DU CHIFFRE, LA MORT DE L’HUMAIN
L’évaluation méthodique des services a gagné l’ensemble du monde occidental dans les années 1990. Elle s’est attaquée en particulier au système de santé et aux universités. Son principe majeur consiste à œuvrer pour optimiser le rapport coût-efficacité. Elle a ainsi introduit l’économie de marché dans des domaines qui en étaient autrefois préservés.
Qui oserait refuser aujourd’hui l’évaluation ? Elle ne veut que le bien général : maximiser la qualité des services rendus et obtenir la meilleure rentabilité des deniers publics. Ces notions ne peuvent apparaître que comme « bonnes » dans une évidence aveuglante : et ceux qui s’y opposent sont « absurdes ». On veut nous faire oublier ainsi que l’évaluation repose sur une logique gestionnaire et sur des techniques de management dont les conséquences sont pires que les bénéfices attendus :
Amputation de l’évalué
L’une des conséquences les plus manifestes de l’évaluation est éminemment paradoxale : l’évaluation ampute d’emblée toute activité à laquelle elle s’attache. Chacun constate dans les faits qu’elle détourne à son profit un temps considérable qui ne peut plus être consacré au travail (évalué). Un chef de service de secteur psychiatrique relate qu’une simple démarche d’auto-évaluation, administrativement incontournable, a mobilisé le quart du personnel pendant seize heures à raison de huit réunions de deux heures, afin de remplir une grille référentielle préétablie, de surcroît non adaptée à la psychiatrie. Le premier effet de l’introduction des procédures de l’évaluation est une perte de productivité qui atteint parfois plus de 20%. Elle écarte le clinicien de ses patients, le chercheur de ses travaux. Elle donne naissance à une bureaucratie parasitaire, qui détourne des ressources à son profit, qui se nourrit du travail d’autrui, qui le mine de l’intérieur. Elle génère des structures nouvelles, organismes divers, qui se greffent sur les institutions. Elle a besoin d’experts toujours plus nombreux. Elle fait appel à des individus de formations diverses pour les initier à la logique gestionnaire, propre à expertiser les institutions de la santé. Que les pratiques de celles-ci soient totalement étrangères aux experts ne peut que les inciter à s’attacher au respect tatillon de grilles préétablies. (...) L’activité évaluative est toujours portée à s’emballer. Elle prône une préévaluation par l’intermédiaire de contrats, elle appelle à l’autoévaluation permanente, elle incite au suivi de l’impact de ses effets, elle crée des évaluateurs des évaluateurs, elle souhaite devenir plus fréquente : elle incite à multiplier les procédures. Elle prolifère. (...)
Au moment où l’on supprime des milliers de postes de fonctionnaires, il est intéressant de savoir que les fonds ne manquent pas pour créer ceux des évaluateurs. (...)
Eric Laurent, dans un travail intitulé « le trou noir des vanités », rapporte que dans le système le plus évalué au monde, les Etats-Unis, les dépenses administratives d’évaluation absorbent près du tiers des dépenses de santé.
Pourquoi le coût considérable de l’évaluation n’est-il jamais distingué en tant que tel ni évalué par les évaluateurs ? Sans doute y reviendrons-nous mais la réponse est : parce que ses avantages sont incommensurables - mais pas pour tous.
Alors que toute évaluation est relative parce qu’elle dépend du choix méthodologique, elle
nous est aujourd’hui présentée comme objective, parée du prestige du chiffre, donc scientifique, donc non interrogeable. On passe sous silence que le modèle mathématique repose en aval sur un choix décisif, celui de chiffrer tel élément plutôt que tel autre, tandis qu’en amont se font d’autres choix, ceux qui opèrent dans l’interprétation des résultats. En matière d’évaluation de l’efficacité des psychothérapies, par exemple, il a été bien établi que les résultats obtenus sont très fortement corrélés à l’allégeance théorique des chercheurs qui ont engagé l’étude : Dans ce domaine, il est assez manifeste que le résultat souhaité détermine la méthodologie employée. Mesurer l’efficacité en référence à l’éradication d’un symptôme n’est pas du même ordre que de l’apprécier en rapport à l’amélioration générale du fonctionnement du sujet. La première mesure étant aisément chiffrable, elle convient mieux aux modernes évaluateurs tandis que la seconde nécessitant une appréciation qualitative est volontiers rejetée comme non scientifique.
(...)
On ne peut que partager l’avis du mathématicien Luc Miller : "le discours évaluationniste, qui revendique l’objectivité parfaite est un délire, qui fait peser sur le chercheur un absolu fallacieux". Qui plus est, ajoute-t-il, c’est une idée dangereuse de penser qu’il puise y avoir une évaluation automatique chiffrée, systématique, complètement objective, et qui vous appelle à participer à cette objectivité, alors que vous avez bien le droit de ne pas être comme les autres, d’avoir une pratique différente. Il y a dans la culture de l’évaluation, le désir d’imposer des normes, d’humilier l’autre, de le faire céder sur son être. Vous avez des chercheurs passionnés à qui soudain on oppose des critères, des modes d’évaluation qui les dévalorisent à leurs propres yeux.
(...)
L’évaluation est par essence ségrégative : elle produit des classements d’individus, elle désigne les meilleurs et stigmatise implicitement les autres. Elle instaure une compétition permanente entre les institutions, les équipes, les chercheurs et les professionnels. Elle porte ainsi atteinte au lien social en constituant comme concurrents et rivaux potentiels ceux qui devraient s’éprouver comme solidaires. Rien de mieux que l’évaluation pour miner la conscience syndicale. Elle produit une sélection de mode darwinien qui conduit par exemple à la partition des universités entre pôles d’excellence scientifiques et collèges universitaires littéraires.
Le coût humain de l’évaluation est lourd : non seulement celle-ci accroît les charges de travail de l’évalué et l’incite à faire toujours plus, mais elle est aussi fondamentalement suspicieuse envers lui. Les activités humaines ont toujours fait l’objet d’une évaluation spontanée, reposant a priori sur une confiance accordée aux institutions et aux professionnels. L’évaluation méthodique commence par retirer cette confiance. Elle instaure une surveillance des évalués, qui augmente avec l’exigence : elle n’a pas à justifier sa foncière suspicion puisqu’elle est inhérente à son fonctionnement.
(...)
L’évaluation quantitative est néfaste, note Michel Saint-Jean, physicien, car elle détruit la coopération entre chercheurs pour ne favoriser que des recherches mises en concurrence et cloisonnées pour être identifiables. Cette conception va à l’encontre de la recherche telle qu’elle a été pratiquée pendant des décennies : la recherche publique, affirme-t-il, réclame la liberté intellectuelle, la confiance mutuelle, des laboratoires permettant des échanges fructueux entre chercheurs et une évaluation de leurs idées, basée sur la confrontation intellectuelle, des organismes capables de dialoguer et de les accompagner.
(...)
Les tenants de l’idéologie de l’évaluation sont porteurs d’un projet de société. Certains en sont conscients, d’autres veulent l’ignorer mais tous refusent publiquement d’en assumer la responsabilité, préférant se camoufler derrière une prétendue objectivité qui n’a en la circonstance rien de scientifique.
(...)
L’évaluation porte en elle une idéologie pernicieuse, parce qu’elle est extrêmement coûteuse d’un point de vue matériel et humain, parce qu’elle désorganise ce qu’elle prétend optimiser, parce que contrairement à ses prétentions, elle n’est jamais totalement fiable, parce qu’elle fétichise le chiffre, parce qu’elle porte atteinte au lien social, parce qu’elle gomme l’acte politique sur lequel elle repose. Pourquoi la prône-t-on malgré tout ? Parce qu’elle présente l’énorme avantage politique de faire consentir subrepticement ceux qui l’acceptent à la logique folle de l’économie de marché totalement dérégulées.
Certes, nous ne pouvons refuser d’entrer dans les mécanismes de l’évaluation, sauf à démissionner des lieux où elle se pratique, mais nous devons refuser d’adhérer à son idéologie, en ne nourrissant pas celle-ci, en ne rêvant pas d’une bonne évaluation, en rappelant sans cesse que le facteur humain excède le chiffre, en résistant pied à pied, en dénonçant ses méfaits et en la révélant pour ce qu’elle est en dernière analyse : un instrument de consentement à l’économie de marché.
UNE NOUVELLE MANIÈRE DE DONNER DES ORDRES ?
« 1l est raisonnable de penser que la multiplication des machines informationnel/es affecte et affectera la circulation des connaissances autant que l’a fait le développement des moyens de circulation des hommes d’abord (transports), des sons et des images ensuite (media).
Dans cette transformation générale, la nature du savoir ne reste pas intacte.
Il ne peut passer dans les nouveaux canaux et devenir opérationnel que si la connaissance peut être traduite en quantités d’information.On peut donc en tirer la prévision que tout ce qui dans le savoir constitué n’est pas ainsi traduisible sera délaissé, et que l’orientation des recherches nouvelles se subordonnera à la condition de traduisibilité des résultats éventuels en langage de machine .
Jean-François Lyotard : (la condition postmoderne).
L’évaluation n’est pas un mot mais un mot d’ordre . (Jean-Claude Milner).
L’empire de l’évaluation s’étend aujourd’hui à presque tous les champs d’existence des individus et des populations. Les expertises technocratiques qu’il installe en lieu et place d’un authentique gouvernement politique repose sur une folle passion de la mesure et de la quantification.
Les machines bureaucratiques remplacent l’autorité des chefs
Si l’évaluation s’impose aujourd’hui comme la nouvelle manière de donner des ordres au nom d’une prétendue objectivité formelle, technique, gestionnaire, comptable, c’est parce que l’autorité est en crise et que les décisions sont escamotées. On les cache, on les pare d’une « neutralité d’eunuque », pour reprendre l’expression de l’historien polonais Johan Droysen. Rien de mieux que les chiffres pour parvenir à assujettir les individus et les masses, et les obliger à incorporer la logique des choses inertes, la subordination des travailleurs aux fonctions qu’exige le système technicien. Sous le couvert d’un déterminisme technoéconomique propre aux modes de production capitalistes s’installe une oppression sociale et symbolique, non seulement dans le champ professionnel mais plus encore dans tous les secteurs de notre vie sociale et subjective.
(...)
Naguère, les « chefs » devaient veiller à la docilité du travailleur, à ce qu’il se soumette aux quelques fonctions exigées par la machine (d’un nombre fini) : désormais, c’est l’organisation bureaucratique, avec son traitement statistique de toutes les données et sa rhétorique d’expertise qui donne aux chefs une légitimité au développement infini de l’oppression sociale.
Comme l’a montré Hannah Arendt, ce qui rend nos sociétés de masse si difficile à supporter et à vivre, ce n’est pas tant le nombre de ses membres, c’est que le monde qu’il y a entre eux, ce monde commun, bien commun, n’a plus le pouvoir de les rassembler, de les relier, ni même de les différencier. C’est à cette perte d’un monde commun que travaille la néo-évaluation, en propulsant l’humain dans un univers où l’existence est réifiée, quantifiée, faussement objective, sans histoire et sans valeur.
La néo-évaluation constitue ce rite social de passage de la culture du capitalisme industriel, historiquement daté et qui se termine vers 1975, à une culture du capitalisme financier, qui se répand à partir des années 1980. Etendue aujourd’hui à tout domaine, elle triomphe. D’où cette prolifération technocratique de l’expertise, sa tyrannie, ses professions de foi et ses certitudes, qui décrédibilisent le travailleur autant que le citoyen, et le dépossèdent de fait de ses activités et de ses droits démocratiques, ce qui permet d’organiser toujours plus au sein même de l’état une culture d’audit et de gestion néolibérale.
Cette culture-là liquide l’autonomie du champ politique et de l’autorité au profit d’une culture de la normalisation et du contrôle social. Comme Michel Foucault l’a montré, nous vivons dans une société toujours plus articulées à la norme et toujours moins à la loi : ’nous sommes entrés dans un type de société où le pouvoir de la loi est en train non pas de régresser mais de s’intégrer à un pouvoir beaucoup plus général : celui de la norme. Ce qui implique un système de contrôle et de surveillance tout autre.’
(...)
Il n’y a rien de mieux que les chiffres pour administrer et gouverner l’humain, administration morale et politique qui se masque autant que possible sous les traits neutres et pseudo-objectifs des statistiques ordinaires et des valeurs numériques. La limitation du politique et la normalisation des mœurs se réalisent par la force homogénéisante et égalisatrice des chiffres qui, en recensant les richesses et les misères du « capital » humain, structure le monde et injecte insidieusement de nouvelles normes morales et intellectuelles. (...)
Tout se passe comme si les sciences humaines s’étaient mises à fabriquer des théories de l’homme dont le néolibéralisme avait besoin pour fonctionner. Ainsi, si l’on peut se réjouir de voir les psychologues engagés dans la lutte contre l’échec scolaire, il est difficile de ne pas s’apercevoir qu’ils ont mis en circulation une conception du savoir qui serait une accumulation de connaissances : les capacités d’accumulation des individus seraient d’ailleurs mesurables à l’aide du quotient intellectuel ou de l’âge mental.
(...)
Nous voyons se développer de plus en plus de pathologies de la consommation : addiction, anorexie, boulimie, traitement alimentaire des conflits et des tensions, vols compulsifs, dépressions : Pourquoi ? Ne peut-on faire l’hypothèse que le sujet, incessamment suggestionné par l’idéologie dominante bien servie par nos psychologies, proteste contre la maltraitance qu’il subit et retrouve les vertus de la résistance du symptôme ?
La référence et le sacré
Pour comparer et hiérarchiser, il faut des critères, certes, mais pas n’importe lesquels : il est mieux que ce soient des critères admis de tous et qui fassent véritablement référence. Dans notre monde moderne - ou post-moderne -, c’est « la science » qui constitue le plus souvent ce point de référence dernier, incontesté. Aussi l’utilise-t-on à toutes les sauces et lui fait-on dire ce que l’on veut.
Mieux que la télé, que Dieu ou que tout autre dogme, la référence à la science est devenue, dans notre système social, argument imparable d’autorité. (...)
Le mythe de l’expérience
Autre référence abusive : celle à l’expérience, que l’on superpose d’ailleurs volontiers à la science : in experimento véritas. Du moment que l’on peut reproduire l’expérience de quelque chose, cela vaudrait pour démonstration, pour preuve. Or rien n’est moins assuré. Et moins pertinent d’un point de vue épistémologique. L’idée que l’expérience - et le recours à celle-ci, surtout- est le geste fondateur de la science n’est ni vraie ni fausse en tant que telle : elle est un mythe, un mythe des origines, que la science peut à l’occasion construire pour son usage propre, comme pour n’importe quel autre discours d’ailleurs. (...) Cette idée contribue à tout embrouiller en laissant croire qu’est scientifique que ce qui a été dûment expérimenté, alors que la plupart des grandes théories scientifiques ont été élaborées avant toute possibilité d’expérimentation, et que beaucoup plus simplement, l’expérience, en toute logique, ne démontre rien : elle met à l’épreuve, elle interroge, et bien souvent aussi elle infirme, elle dément.
L’IMPOSTURE BIBLIOMÉTRIQUE
Etre un « citoyen responsable » : vaste programme. Qui implique, vous diront certains, que l’on sache se tenir pour comptable de ce que l’on a fait, entre autres devant ceux qui vous en ont confié mandat. Ethique élémentaire, n’est-ce pas ? Laquelle n’exige, somme toute, pas grand-chose : simplement qu’on présente son action, qu’on en dresse le bilan, voire qu’on la compare à d’autres, afin d’en établir le bien-fondé, - ou l’intérêt.
N’est-ce pas ce qu’on appelle « l’évaluation » ?
A ceci près que telle que celle-ci se pratique dorénavant, il ne tarde pas à y falloir des critères bien définis : des moyens qui permettent d’établir les comparaisons, de rapporter les éléments jugés à une même aune de garantir la validité du processus. Pour évaluer, il : faut des échelles, des grilles, des questionnaires - une panoplie complète d’expertise transparente, impartiale et bien tempérée.
Ce n’est pas facile à trouver, et encore moins à inventer. De surcroît, ça indispose souvent ceux qui s’y retrouvent passés à la moulinette. Aussi est-il fortement conseillé, pour garantir la justesse de l’évaluation, de s’assurer d’une référence extérieure au système examiné, d’une référence admise par tous, aisément convocable et si possible irrécusable. Dieu, en somme.
Qu’est-ce qu’un « bon chercheur » ?
C’est la, peut-être, que les choses deviennent amusantes, ou pathétiques, au choix. Prenons l’exemple d’un chercheur. Quelqu’un qui est payé pour chercher et de temps en temps pour trouver un petit quelque chose. Encore lui faut-il régulièrement administrer la preuve que c’est bien ce qu’il accomplit. Comment ? En faisant état devant sa communauté scientifique de ses résultats et de la façon dont il les a obtenus. Un bon chercheur, donc, ou plutôt un chercheur tout court, est un chercheur qui publie. Comment savoir si ses méthodes et ses résultats sont valables ? En les lisant, en les étudiant ? Vous n’y êtes pas. Ca, c’est le travail des experts de la revue où il publie. C’est à la revue qu’est maintenant dévolue la fonction d’examiner le travail présenté et d’en garantir le sérieux. Qu’elle accepte un article et elle s’en porte en quelque sorte garante. Ce qui fait donc un bon chercheur, c’est un chercheur qui publie dans de bonnes revues.
Mais comment savoir qu’elles le sont ? Parce qu’elles retiennent des articles en utilisant des critères de sélection plébiscités par la communauté scientifique ? Ne rêvez pas. On considère de plus en plus qu’une revue est sérieuse parce qu’elle est indexée sur une liste de revues connues comme telles par tel ou tel organisme ou par tel ou tel groupe influent. Un bon chercheur est donc un chercheur qui publie dans une revue bien indexée.
Et comment savoir que l’index est le bon, celui qui présente des garanties de sérieux lui permettant d’accréditer légitimement les revues qui elles-mêmes accréditeront les auteurs qu’elles publient ? En consultant l’index des index, bien sûr.
Pour être considéré comme un bon chercheur, il faut dès lors écrire des articles dans de bonnes revues bien indexées, articles qui auront pour principale fonction de citer un certain nombre d’articles d’autres chercheurs. Lesquels, quand ils publieront à nouveau dans les mêmes revues, s’empresseront à leur tour de citer l’article où ils ont été précédemment cités, augmentant ainsi, à la satisfaction générale du groupe dans lequel a lieu cet échange de bons procédés, les « impact factors » de chacun. Un article scientifique est donc un article qui, pour l’essentiel, cite et discute d’autres articles se citant et se discutant les uns les autres.
La boucle est ainsi bouclée : la recherche de la référence dernières garantissant le sérieux de l’entreprise, la recherche de l’Autre de l’Autre, en somme, a directement débouché sur une logique de l’auto-référence, a directement conduit au système le plus endogamique qui soit, garanti stérile à terme. (...)
La révérence au chiffre
Une réserve quand même : ce petit rappel est un peu trop schématique et oublie un élément important : le quantifiable. Dieu devient décidément de plus en plus difficile à convoquer comme point de référence ultime. Mais ses noms sont multiples. La science en est un, à l’occasion. Ou plus exactement l’invocation du « scientifique » en tant que label, marque déposée, poinçon de garantie. Et, à ce niveau d’imaginaire, qu’est-ce qui fait mieux signe de la science que ce qui susceptible d’être quantifié, ce que qui sait se plier aux formes et exigences du nombre ? Dépliera-t-on jamais assez cette merveilleuse croyance que la démonstration, l’assurance du vrai, ont la comptabilisation et la quantification pour voies royales ? Ce qui fait d’ailleurs que ce n’est même plus de nombres dont il s’agit dans l’insigne de la science, mais de chiffres, au sens le plus strict : une écriture secrète qui permet à l’initié de s’assurer du vrai.
Éloge de l’indécidable
Et pourtant ! Que ne puisse plus guère prétendre à la considération sociale que ce qui est estampillé « scientifique » est une chose : mais que la science en soit, sur le plan social désormais réduite à ce rôle et qu’elle le soit sur un mode aussi caricatural en est une autre, une autre affaire qui tend bien à l’inscrire, la malheureuse, dans le registre du religieux.
(...)
Et qu’est-ce que l’indécidable ? Ce n’est pas un concept ésotérique, destiné à impressionner le pékin : c’est une catégorie logique, dont nous allons nous permettre de donner ici un petit exemple :
Cette frase contient quatre ereurs
Quand on est normalement lettré, on se rend compte qu’il y a trois fautes d’orthographe. On cherche la quatrième et on constate qu’il n’yen a pas. Puis, si l’on réfléchit un peu, on se dit que la quatrième erreur, c’est précisément d’en annoncer quatre alors qu’il n’y en a que trois. La quatrième erreur est de contenu. Et c’est alors que ça devient amusant. Et intéressant. Parce que si la phrase contient quatre erreurs, alors elle est juste. Et ne contient plus cette quatrième erreur. Ce qui, tout aussitôt, la rend à nouveau fausse. Donc juste. Et si juste, alors fausse. Et ainsi de suite. On n’en sort pas. Le juste implique le faux, lequel implique le juste, et cela à l’infini. C’est cela, l’indécidable.
Et un scientifique, pour nous, est précisément celui qui sait penser les choses dans ce système conceptuel, (ce que fait, et pas qu’un peu, la psychanalyse, ne l’oublions pas). Seulement, évidemment, l’indécidable donne des boutons aux évaluateurs, ou en tous cas, à certains évaluateurs : c’est le reste, la particule autour de laquelle se constitue la perle de la science, mais aussi le grain de sable qui fait boiter bas ceux qui confondent cette dernière avec le culte du quantifié.
Voilà donc comment nos sociétés de paroles se mutent en sociétés de l’information. L’information n’est que la part technique de la parole, son fragment commensurable, la part la plus à même de se faire marchandise. La transformation de la parole en « marchandises informationnelles », solubles dans le système numérique, détermine de nouvelles règles pragmatiques qui constituent les nouvelles formes du lien social, et participent à la construction d’un nouvel espace politique, remodelant en profondeur le concept de démocratie.
C’est donc une nouvelle « pragmatique » des discours, au sens fort du terme, à la fois épistémologique, éthique et politique, qui se met en place dans cette perspective post-moderne, et celle-ci minore le savoir narratif au profit des savoirs techniques.
Ce concept de valeur se trouve transformé de fond en comble, dans sa nature et sa fonction, par les nouvelles règles pragmatiques de la marchandise informationnelle.
La dévalorisation incessante du savoir narratif au profit d’une rationalité technique a constitué la signature de l’Occident depuis le début mais jamais autant qu’avec la naissance du capitalisme, cette forme de rationalité qui s’est imposée pour commander les conduites et civiliser les mœurs.
(...)
L’évaluation en tant que moyen susceptible de donner une valeur à des actes ou à des services devient elle-même sa propre fin et désavoue du coup les objectifs qui étaient les siens et pervertit du même coup sa raison d’être.
(...) Il risque de « saper tout ancrage de l’action dans des valeurs éthiques ». la néo-évaluation appartient, selon moi, de pied en cap, dans sa nature et sa fonction, à ce dispositif d’évitemment des valeurs éthiques dans le lien social, par une rationalité pratico-formelle qui s’installe ainsi dans le vide qu’elle a fabriqué.
(...)
Concluons
Tout discours au sens fort du terme, porte en lui-même un conflit potentiel, en puissance si ce n’est en acte, celui des différents style de rationalité qui traversent les champs des savoirs et des pratiques. Que la rationalité pratico-formelle permette la réussite en affaires, dans le commerce ou qu’elle soit fort utile dans l’exercice du droit ou de la gestion technico-administrative, ne saurait être en soi condamnable. Bien au contraire, dans de tels champs, au sens de Bourdieu, les logiques de distinction, les économies symboliques qui les organisent et s’y matérialisent dans des savoirs et des pratiques rendent cette forme de rationalité utile et indispensable.
(...) La où commence le champ de la rationalité substantielle propre aux valeurs morales, s’installe dans une culture dominée par la rationalité pratico-formelle l’utilitarisme le plus cynique, propre à favoriser toutes les dérives.
On constatera ici combien la néo-évaluation est à ce titre éloignée de la loi morale puisqu’elle ne s’intéresse qu’aux produits et non aux processus de production.
(...)
Il y a des domaines de connaissance et d’action où les ravages de ces dispositifs sont limités, voire quasiment sans conséquences, et d’autres où ils sont terrifiants car la rationalité pratico-formelle est incompatible avec la finalité spécifique des métiers auxquels elle s’impose : notamment le soin, l’éducation, la justice, le travail social, la recherche, la culture etc.
Comme l’écrit Pasolini : « le véritable fascisme est celui qui s’en prend aux valeurs, aux âmes, aux langages, aux gestes, aux corps du peuple, et qui mène, sans bourreaux ni exécutions de masse, à la suppression de larges portions de la société elle-même. »
Oublions cette profonde parole de Benjamin écrite en 1933 : « il y a une chose que peut l’adulte : marcher - mais une autre qu’il ne peut plus - apprendre à marcher. « Là est la véritable valeur, non dans le comportement de marcher mais dans le geste d’apprendre, qui rend tout autant possible la maturité que la démocratie.
Alain Abelhauser Roland Gori, Marie-Jean Sauret
A partir d’un article publié par ATTAC
extraits choisis par Michel Simonis